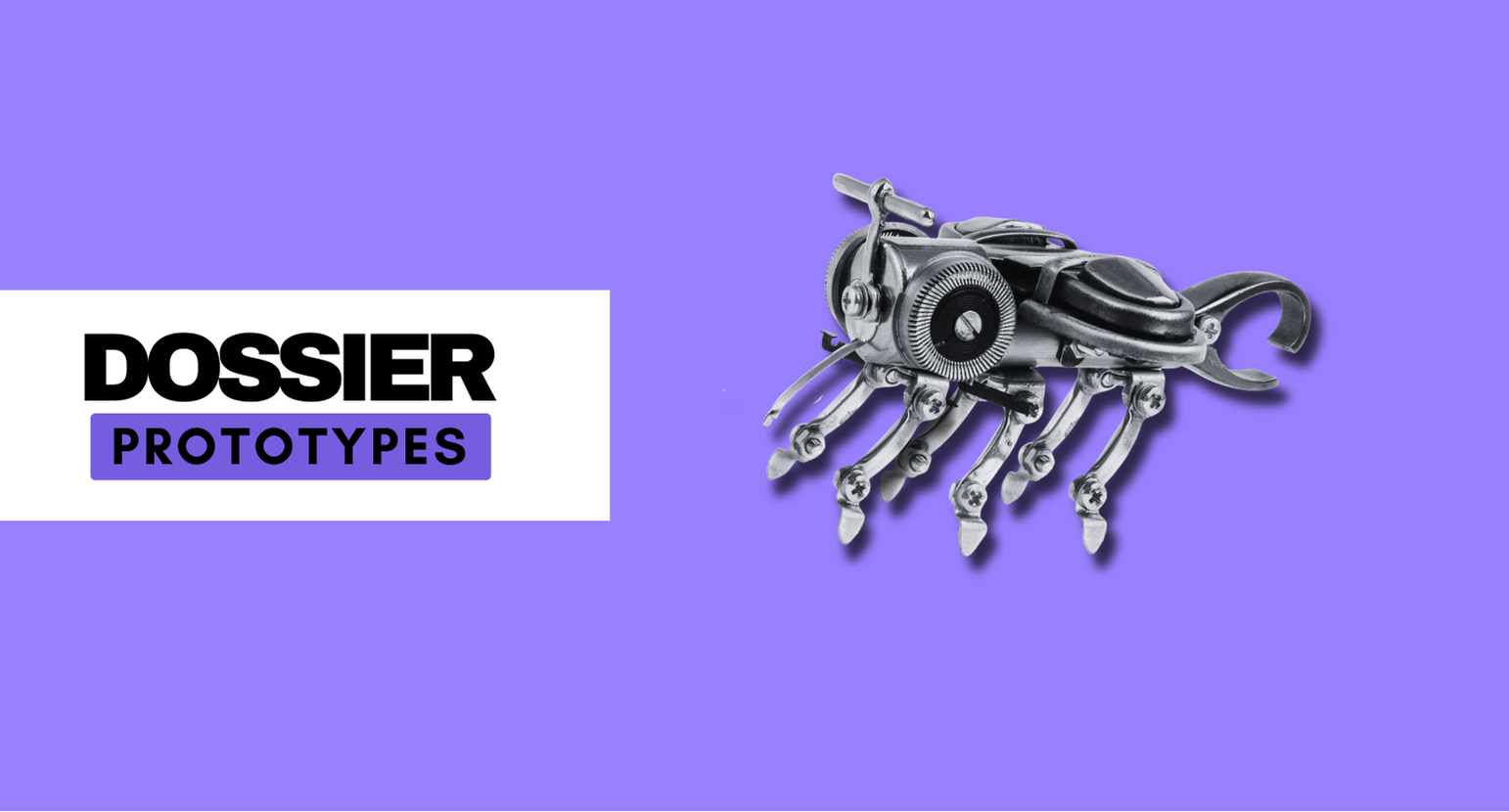De l’écorce de platane pour mesurer la pollution de l’air

Les habitant·es des grandes villes sont exposé·es à de fortes concentrations de particules fines émises par le trafic routier. Mais, que deviennent-elles ? Les retrouve-t-on dans les logements, dans les écoles de nos enfants ? Mélina Macouin, géophysicienne et chercheuse CNRS au laboratoire Géosciences environnement Toulouse, a conçu un capteur en écorce de platane pour les tracer, en coopération avec les habitant·es, des écoles et la mairie de Toulouse. La chercheuse détaille le dispositif et sa démarche participative.
Comment avez-vous eu l’idée de mesurer la pollution de l’air toulousain avec des écorces de platane ?
Mélina Macouin : J’étais en vélo sur le Canal du Midi et un jour de pic de pollution, j’ai eu l’idée de récolter des écorces tombées des platanes et de les étudier au laboratoire. L’écorce de platane a la particularité d’être poreuse et de piéger les particules, elle a aussi l’avantage de tomber tous les ans, ce qui permet de la récolter sans risque pour l’arbre et d’obtenir un échantillon de la pollution cumulée au cours de l’année. Les résultats de ces tests réalisés en laboratoire ont été probants : il y avait une corrélation entre le niveau de concentration en oxyde de fer présent dans l’écorce des arbres et l’intensité du trafic routier. C’est là que l’idée a germé : ces écorces pouvaient être transformées en capteurs de particules fines métalliques et utilisées pour spatialiser la pollution urbaine et mesurer le transfert de ces polluants de l’extérieur vers l’intérieur des habitations. C’est un sujet qui reste peu documenté, alors que l’on sait que les citadin·es passent l’essentiel de leur temps à l’intérieur des habitations.

Votre étude, nommée NanoEnvi a débuté au printemps 2018 et impliqué 165 habitant·es volontaires. Pourquoi avez-vous choisi d’associer les habitant·es à votre recherche ?
M. M. : Parce que ces capteurs en écorce se prêtent bien à la démarche participative : ils sont le plus neutres possibles, que ce soit en termes d’impact environnemental, de coût et d’accessibilité et constituent un excellent support de sensibilisation à la pollution atmosphérique. L’objectif de cette démarche de science participative, c’est de démocratiser la notion de mesure de la qualité de l’air, afin que chacun et chacune puisse comprendre ce que cela recouvre, pour changer éventuellement son comportement et surtout peser sur les politiques urbaines.
Comment avez-vous procédé pour recruter des volontaires ?

M. M. : Le capteur que nous avons développé se présente sous la forme d’une guirlande composée de petits carrés d’écorce propres, sans polluants. L’enjeu, c’était de trouver des habitant·es réparti·es sur le territoire qui acceptent d’installer un capteur en façade ou sur le balcon et un second à l’intérieur du logement et de les garder pendant un an. Nous nous sommes associés avec des scientifiques issu·es d’autres disciplines : sciences physiques, urbanisme et sociologie. Nous avons organisé des conférences, des réunions dans différents quartiers de Toulouse, des ateliers de démonstration et distribué nos kits. Au terme d’un an, nous avons recueilli 180 biocapteurs placés dans 90 logements, soit près de 60% des dispositifs distribués. Les résultats ont été restitués aux participant·es en 2020.
Comment mesurer les particules fines en suspension dans l’air ?
M. M. : Les particules fines sont émises principalement lors des phénomènes de combustion des moteurs, par l’abrasion des freins, l’embrayage et l’usure des pneus. Les méthodes magnétiques, en l’occurrence avec un magnétomètre (un appareil qui mesure l'aimantation d'un échantillon), permettent d’identifier et de quantifier les oxydes de fer, marqueurs de la pollution. Plus il y a de particules d’oxyde de fer, plus il y aura une aimantation de l’écorce. On peut ainsi détecter la quantité des oxydes de fer de taille nanométrique, inférieure à 0,1 micromètre. L’étude au microscope électronique permet ensuite de différencier celles qui ont pour origine la combustion des moteurs et celles issues de l’usure du véhicule, en fonction de la forme de la particule qu’on observe.

Contrairement aux particules fines, appelées les PM2.5 et qui sont réglementées, les nanoparticules ne le sont pas, ce sont pourtant les plus dangereuses pour la santé !
M. M. : Selon l'agence Santé publique France, l’exposition chronique aux PM2.5, c’est-à-dire les particules dont la taille est de 2.5 micromètres, serait responsable de 40 000 décès prématurés par an. Les nanoparticules sont encore plus nocives, car elles pénètrent profondément dans l’organisme. Elles arrivent aux alvéoles pulmonaires et atteignent la plupart des organes via le système sanguin et sont à l’origine de maladies respiratoires, cardiovasculaires, neurologiques et de cancers. La plupart des grandes agglomérations, dont Toulouse, présentent des concentrations importantes, liées au trafic routier.
Quels sont les principaux enseignements que vous tirez du projet NanoEnvi ?
M. M. : Les résultats indiquent une grande diversité d’exposition aux particules en fonction de la localisation des habitats par rapport au trafic routier, mais aussi à l’échelle d’une même rue. L’étude révèle que l’aménagement urbain a une forte incidence : la présence de feux de circulation, les carrefours, la forme des rues et leur végétalisation sont des facteurs importants. De manière générale, l’intérieur des logements des participant·es présente une concentration moindre en particules que les extérieurs associés.
Pour se protéger des particules fines venues du trafic automobile, il faudrait donc se calfeutrer ?
M. M. : Non, il faut ventiler régulièrement les habitations, ne serait-ce que pour réduire la pollution liée aux activités domestiques ou professionnelles ! Se calfeutrer n’empêche pas les particules fines liées au trafic routier de s’introduire via les personnes et les objets dans les habitations. À l’extérieur, elles se déposent sur les vêtements, les cheveux, les sacs et se retrouvent dans les maisons et les bureaux. Tous nos mouvements remettent en suspension les particules que l’on transporte avec soi. Plus il y a de personnes dans un espace intérieur, plus il y a d’apports de particules fines et plus l’exposition est importante.
C’est ce qu’a montré l’étude menée ensuite, dans deux écoles élémentaires toulousaines proches de grands axes routiers, avec notamment une surexposition des enfants aux particules fines dans les classes…
M. M. : Sachant que les enfants passent une grande partie de leur temps à l’école et qu’ils sont particulièrement fragiles en raison de l’immaturité de leurs systèmes respiratoires et neurologiques, nous avons étudié la qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur dans deux écoles proches du périphérique. Notre démarche a été la même : nous avons organisé des ateliers sur les propriétés magnétiques, des débats sur la pollution de l’air et posé des capteurs en écorce et d’autres dispositifs de qualité de l’air pendant six mois. Les résultats révèlent une surconcentration de nanoparticules émises par la circulation automobile à l’intérieur des classes, notamment pendant les périodes froides. La proximité des grands axes routiers et la mauvaise ventilation des classes sont les principales causes de cette accumulation des particules en suspension. En 2024, ma collègue Sonia Rousse, chercheuse IRD au laboratoire Géosciences environnement Toulouse, poursuit ces investigations sur la qualité de l’air avec un nouveau projet baptisé Coop’Air dans deux écoles primaires et deux collèges à Toulouse et à l’Union.
Ces expériences de sciences collaboratives ne risquent-elles d’accroitre l’éco-anxiété des participant·es, notamment lors de la restitution des résultats ?
M. M. : Il faut reconnaitre que le rôle du comportement individuel est très limité ! La frustration reste forte. C’est ce qu’a montré l’étude sociologique menée lors de l’expérience NanoEnvi. Les participant·es évoquent des sentiments d’impuissance et souhaitent s’impliquer davantage dans la lutte contre la pollution atmosphérique dans leur ville. Ils et elles ont exprimé une grande motivation à nous aider et à contribuer à nos recherches sur la qualité de l’air. Le fait de savoir et surtout d’être acteur et actrice du changement permet à chacun·e d’acquérir un pouvoir d’agir pour demander aux pouvoirs publics des aménagements pour améliorer la qualité de l’air. C’est ce qu’on appelle l’empowerment (parfois traduit par « empouvoirement » ou « autonomisation », en français, renforçant la capacité d’individus ou de groupes sociaux à agir pour participer aux décisions ou aux projets les concernant et garantir leur bien-être), j’y crois beaucoup.
Vous travaillez sur un nouveau projet de bio-surveillance avec des écorces d’eucalyptus au Sénégal, à Sébikotane sur le modèle de NanoEnvi. Pouvez-vous en dire quelques mots ?
M. M. : Il s’agit du projet AirGeo (porté par l’agence internationale Belmont Forum et l’Agence nationale de la recherche), dont l’objectif est également d’initier des dispositifs de sciences participatives pour produire des mesures de pollution de l’air. L’expérience se déroule à 45 km de Dakar, à Sébikotane, une ville d’environ 30 000 personnes potentiellement exposées aux particules émises par trois usines de recyclage de métaux. Deux cent capteurs en écorce d’eucalyptus ont été réalisés avec des designers dans un fablab à Dakar, puis déployés dans quatre quartiers pendant six mois. Ils ont donné lieu à des ateliers et débats en collaboration avec des chercheurs et chercheuses en anthropologie, médecine et géophysique. Une première restitution a été faite sous la forme de théâtre forum et d’expositions avec les habitant·es et des artistes. Un collectif autour de la qualité de l’air a été créé dans la foulée et le directeur d’une usine de recyclage a déjà décidé d’agir pour réduire ses rejets, preuve de l’efficience de cette démarche associant scientifiques et citoyen·nes.
Mélina Macouin est chercheuse CNRS en géophysique au sein du laboratoire GET – Géosciences environnement Toulouse (OMP, CNRS, Université de Toulouse, IRD, Cnes).
Les laboratoires impliqués dans l’étude NanoEnvi sont : laboratoire géosciences environnement Toulouse - GET (OMP, CNRS, Université deToulouse, IRD, Cnes) ; laboratoire d’aérologie - LAERO (OMP, CNRS, Université de Toulouse) ; laboratoire de physique et chimie des nano-objets - LPCNO (CNRS, Université de Toulouse, INSA Toulouse) ; centre d’élaboration des matériaux et d’études structurales - CEMES (CNRS) ; laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires - LISST (CNRS, Université Toulouse - Jean Jaurès) ; observatoire Midi-Pyrénées - OMP (CNRS, Université de Toulouse, IRD, Météo France, Cnes).
Aller plus loin :
« Qui cherche cherche : Mélina Macouin », Jacques Mitsch, CNRS et Science Animation, 2018
Projet NanoEnvi : participez à la science : Que deviennent les nanoparticules émises par le trafic routier dans la ville de Toulouse ?
Publication scientifique :
« Barking up the Right Tree: Using Tree Bark to Track Airborne Particles in School Environment and Link Science to Society », GeoHealth, A. d. S. Leite, S. Rousse, J.-F. Léon, R. I. F. Trindade, S. Haoues-Jouve, C. Carvallo, M. Dias-Alves, A. Proietti, E. Nardin, M. Macouin, 2022
Les dossiers Exploreur de la Communauté d'universités et établissements de Toulouse explorent un sujet en croisant le regard de plusieurs disciplines scientifiques. Journaliste : Carina Louart. Coordination et suivi éditorial : Catherine Thèves, Clara Mauler, Sandrine Tomezak, Julie Pelletanne, Sylvie Etcheverry, Valentin Euvrard, Simon Leveque.