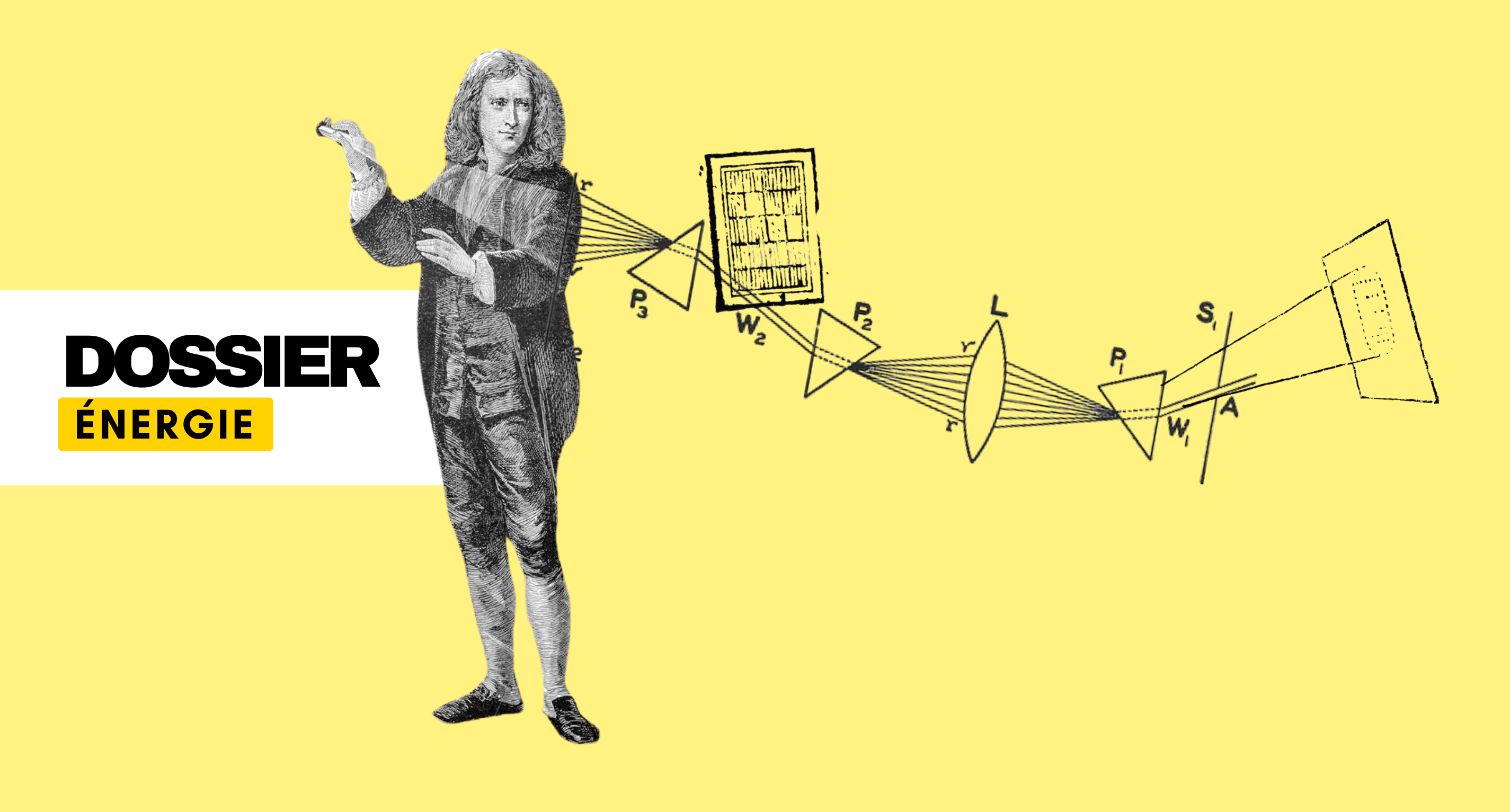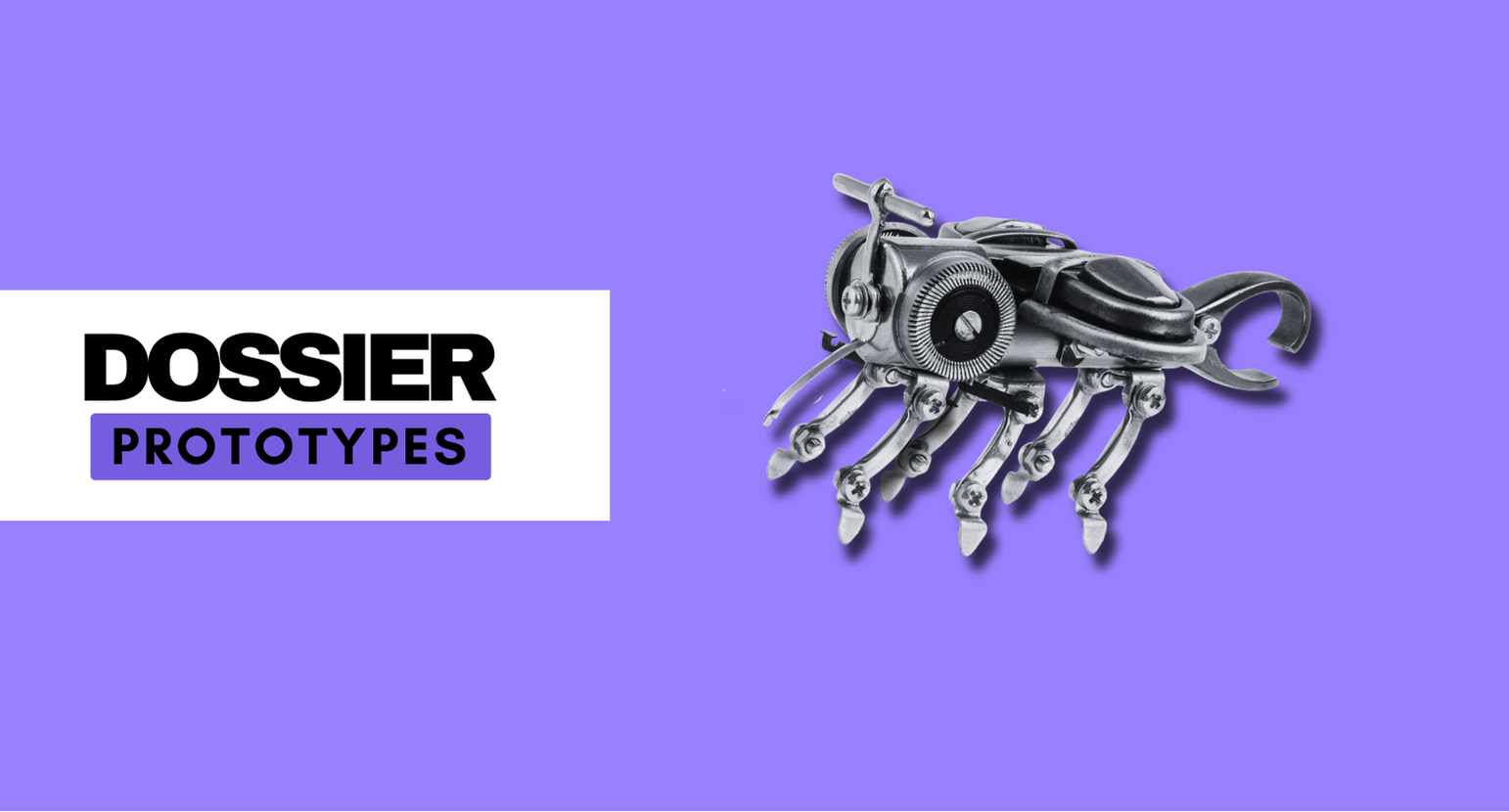Une innovation low-tech pour se laver les mains

À Dakar, une équipe d’inventeurs a mis au point un lave-mains sans contact pendant la pandémie de Covid-19. La machine, fabriquée entièrement avec des matériaux réemployés, fonctionne sans source d’énergie et consomme dix fois moins d’eau qu’un robinet automatique. Une innovation « low-tech » que ses créateurs espèrent faire breveter et qui ouvre la réflexion sur une autre approche des nouvelles technologies, plus respectueuse de l’environnement.
Sur l’esplanade de la Grande Mosquée de Dakar, au Sénégal, la machine fait désormais partie du paysage. Au milieu des 20 000 fidèles les jours de grandes affluences, le cube surplombé d’une petite pyramide ressemble à une minuscule maison autour de laquelle on vient tendre les mains. L’installation, en place depuis la pandémie de Covid-19, permet de se laver les mains sans toucher à rien. Ici, deux pédales s’activent avec les pieds, une pour faire couler l’eau, l’autre pour le savon. Le tout fonctionne sans électricité. Les liquides, stockés dans des grands bidons à l’intérieur de l’objet, s’écoulent seulement grâce à la gravité.

Un bricolage à la Lévi-Strauss
Cette invention est la fierté d’une équipe d’inventeurs du fablab dakarois Defko Ak Ñëp, qui signifie en langue wolof « fais-le avec tout le monde ». Un principe pris au mot par le collectif pour le moins hétéroclite. On y trouve des soudeurs, un artiste, un ancien instituteur, un médiateur culturel, des ingénieurs et un anthropologue du CNRS (centre national de la recherche scientifique). En 2020, alors que le pays est mis à l’arrêt par la pandémie de Covid-19, ils cherchent une solution pour limiter la propagation du virus.

« À cette époque à Dakar, tout un tas de dispositifs est apparu dans la rue pour se laver les mains facilement. Le plus souvent on voyait un bidon bricolé avec un robinet et un peu de savon, mais on se rendait compte que ça ne marchait pas très bien. Les dispositifs étaient petits et ne correspondaient pas aux besoins », explique Yann Philippe Tastevin, anthropologue français au CNRS et l’un des inventeurs du lave-mains collectif.
L’équipe réfléchit alors à un projet simple à mettre en place et peu onéreux, uniquement à partir d’objets récupérés pour qu’il puisse être entièrement réalisé sur place. « C’est du bricolage comme le définit l’anthropologue Claude Lévi-Strauss dans son livre La Pensée sauvage. C’est-à-dire faire avec les moyens du bord. On est dans des logiques de réassemblage. On est dans la figure du bricoleur qui fait avec, contrairement à la figure de l’ingénieur qui planifie », analyse le scientifique, dont les travaux de recherche s’articulent autour des technologies et des innovations simples, durables, appropriables et résilientes dans les pays du Sud et le recyclage des déchets dans une économie mondialisée. Un concept tout sauf théorique pour Bassirou Wade, soudeur hors pair, designer autodidacte et l’un des pères du projet. Ce bricolage, c’est son quotidien.
« Je récupère toujours tout ce que je peux. Les pièces de motos, de vélos… C’est avec ça que je travaille. Tout finit toujours par servir. Ici, rien ne se jette ! » raconte le Sénégalais, déjà connu à Dakar pour transformer des motos en tricycles pour des personnes à mobilité réduite.
L’objectif : un brevet déposé par le CNRS
Au final, le prototype du lave-mains sera constitué de câbles de moto et de freins de vélo, de pédales, d’un bidon d’occasion… Ce qui ne l’empêche pas d’afficher des performances plus que satisfaisantes. Grâce à un assemblage de durites (tuyaux de caoutchouc ou silicone) de motos et de valves de pneus vélos qui régule le débit d’eau, un lavage de mains de 30 secondes ne consomme que 100 ml d’eau, c’est dix fois moins qu’un robinet automatique à détection infrarouge. Alors avec son bidon de 200 litres, le lave-mains collectif permet 2000 lavages.
Testée en condition réelle dans des lieux à forte affluence comme la Grande Mosquée de Dakar, la machine s’est montrée résistante. Une victoire pour l’équipe qui a déposé une déclaration d’invention auprès du CNRS, une première étape vers un brevet qui permettrait de protéger les droits des inventeurs sur leur création.
Mais pour l’obtenir, il faut que l’organisme public français de recherche scientifique reconnaisse le lave-mains collectif comme une innovation. Et c’est là que réside l’un des enjeux majeurs de cette création.
« C’est une question compliquée : par où passe l’innovation quand on recombine l’existant ? Nous, on l’a vendu comme une innovation dix fois plus efficace qu’un robinet infrarouge et qui fonctionne sans électricité. Mais est-ce que c’est une innovation d’un point de vue juridique ? C’est au CNRS de trancher et c’est une question décisive pour la low-tech », expose l’anthropologue.
Low-tech contre high-tech, une bataille pour l’environnement
La « low-tech » (basse technologie en bon français), c’est l’inverse de la « high-tech ». Le terme est apparu dans les années 1970 lorsqu’une pensée critique de la haute technologie a émergé. Il désigne des technologies dites durables grâce aux faibles ressources naturelles nécessaires à leur fabrication, contrairement aux hautes technologies gourmandes en terres rares, métaux et énergies fossiles. Aujourd’hui, à l’heure où la situation environnementale alarme les spécialistes et une part de plus en plus large de la population, cette approche alternative de l’innovation paraît plus que jamais d’actualité.
« Aujourd’hui, la masse anthropogénique, c’est-à-dire la masse de tous les objets fabriqués par les humains, dépasse celle de toute la biomasse de la planète. Alors maintenant, qu’est-ce qu’on fait de tous ces objets déjà là ? » s’interroge Yann-Philippe Tastevin, qui verrait dans la reconnaissance de cette invention par le CNRS une légitimité accordée à la low-tech.
Une révolution verte chez les jeunes créateur·rices
Cette envie d’une innovation plus sobre semble gagner du terrain, notamment à l’École supérieure d’art et design Saint-Étienne (ESADSE) où un groupe d’élèves a également travaillé sur ce projet de lave-mains. Pour l’édition 2021 de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne, des étudiant·es ont fabriqué en France une deuxième version de la machine. Une V2 avec un nouvel aspect et de nouvelles améliorations, là aussi avec les moyens du bord. Pour les aider à assembler des pièces chinées sur Leboncoin et dans les fermes des alentours, Bassirou Wade, le soudeur sénégalais co-inventeur de l’objet, a fait le déplacement.
« En une semaine, il fallait qu’on fasse quelque chose d’attractif, vite et pour pas cher. Parce que souvent le low-tech ça fait penser à des objets rafistolés à la Mad Max, alors qu’on peut faire quelque chose de beau et qui donne envie. C’est aussi ça l’enjeu de la low-tech. », détaille Elen Gavillet, enseignante à l’ESADSE et designeuse indépendante.
En quelques jours, les étudiant·es parviennent à mettre au point un objet fonctionnel avec de belles vasques en céramique et une amélioration notable : des mousseurs récupérés sur des produits cosmétiques pour utiliser moins de savon. Un projet parfaitement en phase avec les nouvelles aspirations des élèves.
« Aujourd’hui les étudiants et étudiantes ne veulent plus créer sans prendre en compte les enjeux environnementaux. Ils et elles ne veulent plus créer de nouveaux objets, alors qu’on croule déjà sous de trop nombreux objets en plastique. Ils sont critiques d’Ikea et considèrent la surproduction comme un ancien modèle polluant. Ils ont le fantasme de créer sans polluer, sans culpabiliser », observe Elen Gavillet. « C’est une révolution, un changement profond lié à une toute nouvelle génération. Encore en 2015, quand moi j’ai été diplômée, ces questions environnementales étaient complètement absentes. »
La technologie ultime : low-tech ne veut pas dire absence de progrès
Ici aussi, récupérer des objets pour les réutiliser apparaît aujourd’hui comme une nécessité. Mais si l’idée semble s’imposer chez cette nouvelle génération de créateur·rices, son élargissement à l’ensemble de la population n’est pas encore gagné. « Quand on parle de low-tech, beaucoup de personnes pensent que ça signifie vivre comme les hommes des cavernes. Alors que la low-tech ne veut pas dire absence de progrès. Certaines technologies qui peuvent être considérées comme low-tech sont pour moi des technologies ultimes, comme des systèmes naturels d’aérations qui existaient dans les pays chauds », argumente Elen Gavillet.
Avec ses promesses de développement durable, la low-tech, ou l’art de faire du neuf avec du vieux, pourrait séduire un public de plus en plus large dans les années à venir, des designer·euses aux ingénieur·es. Mais quelle pourrait être sa place dans un monde industriel davantage enclin à opter pour l’obsolescence programmée que pour des produits durables ? Peut-on produire des technologies low-tech comme le lave-mains collectif à grande échelle tout en respectant la philosophie du réemploi ? Plus qu’une alternative technologique, la low-tech apparaît également comme une autre façon d’envisager le monde et semble indissociable d’un mode de vie plus sobre.
Yann-Philippe Tastevin est chercheur CNRS et anthropologue au laboratoire Environnement, santé, sociétés - ESS (CNRS, CNRST, Université Cheikh Anta Diop, Université de Bamako, Université Gaston Berger). Lors du projet, il était rattaché au Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires – LISST (CNRS, Université Toulouse - Jean Jaurès – UT2J).
Aller plus loin :
Lave-mains de ker Thiossane, fablab DEFKO AK NIEP, Afropixel TV, avec le soutien de #ArtsCollaboratory, 2020
Publication scientifique :
« Chronique d’une conception - Expérimenter en situation de crise » , Azimuts, Yann Philippe Tastevin, 2021
Les dossiers Exploreur explorent un sujet en croisant le regard de plusieurs disciplines scientifiques. Journaliste : Emilien David. Coordination et suivi éditorial : Catherine Thèves, Clara Mauler, Sandrine Tomezak, Julie Pelletanne, Valentin Euvrard, Élodie Herrero, Simon Leveque.