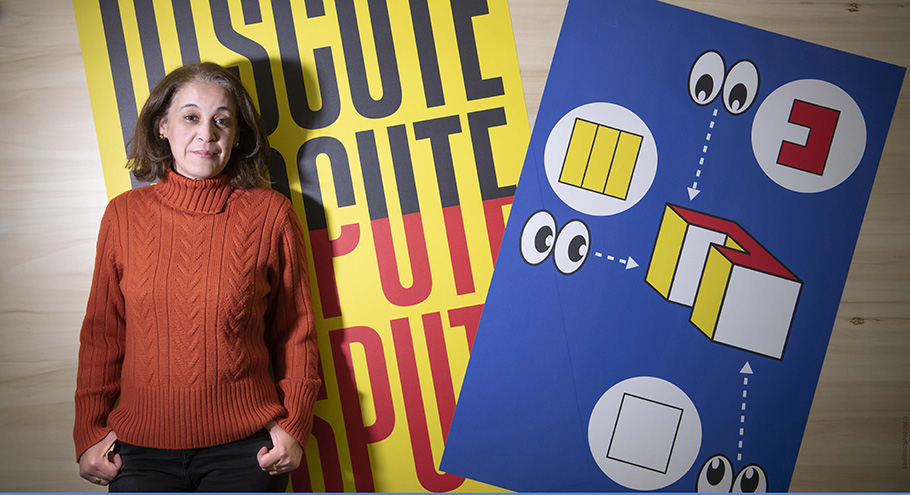La radicalisation religieuse, une affaire de famille ?

Alors que se déroule le procès des attentats du 13 Novembre 2015, la question de la radicalisation djihadiste reste en suspens. Comment en vient-on à commettre de tels actes ? Quel est le poids de la religion, de l’environnement social et familial dans ce processus de radicalisation djihadiste? Dans l’ouvrage « Famille et djihadisme », qu’il publie avec Farhad Khosrokhavar, le sociologue Jérôme Ferret s’intéresse à la famille de ces individus, mais aussi à celle, largement fantasmée, qu’ils ont souhaité recréer.
Propos recueillis par Carina Louart, journaliste.
Six ans après les attentats de Paris de novembre 2015, où en est-on des études sur la « radicalisation » ?
Jérôme Ferret : on peut dire schématiquement que deux types de recherche cohabitent et peuvent s’affronter sur le marché scientifique au risque d’ailleurs de courir le danger d’une sur-étude: celles qui ont une visée disons plutôt sécuritaire qui se focalisent sur la constitution des réseaux, les signalements, les informations susceptibles d’identifier les terroristes, leurs caractéristiques permettant de définir un profil type, le « profiling », et celles qui émanent d’une autre tradition en science sociale, même si cette communauté n’est pas unifiée, qui vise à comprendre les formes de « radicalisation » et ses causes.
Quelle est votre contribution à la compréhension de ces phénomènes de radicalisation, sur quelles variables travaillez-vous en priorité ?
Beaucoup de travaux sont proposés, mais curieusement les territoires concrets sur lesquels ces phénomènes de radicalisation se produisent sont souvent oubliés et fondues dans des analyses finalement assez décontextualisées ou très centrées sur les personnes « radicalisées ». Nous croyons que les réponses à ces phénomènes sont à rechercher dans une dynamique infra-politique entre des rapports familiaux, affectifs et le territoire concret, en tant que lieu de fabrication de la « radicalisation ». Notre livre est ainsi le produit de cette intuition développée collectivement dans le cadre de notre plateforme interdisciplinaire « Radicalités et régulations (RadiRégu) » créée à la MSHS-T en 2015 regroupant 25 chercheurs issus de 7 disciplines. Il est le résultat de trois années d’enquête empirique menées sur le terrain dans le sud de la France, essentiellement dans la région de Toulouse mais aussi au nord de l’Espagne. Nous avons récolté des données variées, rencontré des familles, des travailleurs sociaux, de ces territoires. Toutes ces monographies visent à comprendre les processus de radicalisation étant entendu qu’il n’y a pas de causalité unique ni de déterminisme strict dans aucun des résultats de la recherche. La radicalisation est un phénomène très complexe.
La plupart des recherches s’intéresse à l’ « individu radicalisé » en tant qu’être exclusif. Pourquoi avez-vous choisi l’anthropologie de la famille comme approche ?
Parce que depuis la parution de l’ouvrage important de Farhad Khosrokhavar de 2018, Le nouveau jihad en occident, nous croyons à la nécessité d’analyser la « personne djihadiste » insérée dans un réseau relationnel, affectif et en particulier la famille. Ce que dit la sociologie depuis toujours d’ailleurs. Il faut préciser que nous entendons la famille au sens métaphorique du terme, sous sa forme imaginaire et fantasmée mais aussi la famille réelle en tant qu’institution, organisation sociale structurante, lieu concret de construction et d’incubation et espace vivant de relations. Nous considérons en effet que la « famille » est un des piliers de la socialisation au djihad. Selon nous, ce niveau familial assure la médiation entre l’individu, sa subjectivité et le monde global incarné dans cette offre idéologique qu’est le djihadisme, via notamment les réseaux sociaux.
Votre ouvrage analyse les relations familiales et affectives des membres des cellules radicalisées de la filière dite de « Cannes-Torcy », de « Ripoll » en Catalogne espagnole, de la communauté d’Artigat que les Merah ont fréquentée. Beaucoup ont vécu dans des familles en crise, totalement déstructurées… Cela favorise-t-il la radicalisation ?
Tous les jeunes ayant eu une enfance marquée par une crise familiale ne deviennent pas djihadistes, bien évidemment, mais si on inverse la corrélation : la grande majorité des jeunes que nous avons rencontrés ont en commun un dysfonctionnement familial. C’est une cause favorisante à expliciter au sens du grand sociologue Max Weber. Ces familles djihadophiles sont éclatées, recomposées, déstructurées, traversées par des conflits importants et parfois violents. Il y a des divorces, des remariages, des décès, des trahisons, des abandons, de la brutalité physique et psychologique. Les Merah étant l’archétype de la famille éclatée organisée autour de la violence entre parents, parents et enfants ou entre les membres de la fratrie. Ces dysfonctionnements conduisent ces jeunes à vouloir s’extraire de la cellule familiale et à rallier un groupe faisant office de complément ou de substitut à la famille déficiente. Cette quête d’une nouvelle famille est au cœur du processus de radicalisation djihadiste dans les cellules que nous avons observées. Il faut souligner que cette ré-islamisation ou cette conversion à l’Islam se fait en accéléré, parfois en l’espace de quelques mois.
Vous analysez aussi les dynamiques familiales de la famille Merah. Pourquoi revenez-vous sur cette affaire qui date de 2012 ?
Parce que ces attentats de Montauban et de Toulouse en 2012 constituent une rupture, un marqueur fort dans l’histoire du djihadisme européen. Ce jeune homme qui va tuer sept personnes, dont trois enfants de confession juive abattus à bout portant et filmés en caméra GoPro a provoqué un état de sidération qui a eu un retentissement international. Sa façon d’agir en solitaire, avec en réalité toute une organisation familiale derrière au sens imaginaire, en l’occurrence la communauté d’Artigat, l’hyper-violence médiatisée de ces actes, c’est quelque chose qui n’avait jamais été imaginé, ni même anticipé y compris par les sciences sociales. M. Merah est une personne née en France qui a grandi et été scolarisé sur le territoire français mais qui, au nom d’une idéologie politique et religieuse va pourtant se retourner contre son État d’appartenance de la façon la plus violente qui soit : par la voie terroriste. Il incarne un nouveau type de djihadisme et annonce la série d’attentats commis par d’autres se réclamant souvent de ses actions, au nom du groupe Etat Islamique dans le contexte de la guerre Syrienne.
Toutes ces familles connaissent aussi des problèmes d’autorité. Vous évoquez souvent la figure du père absent ou défaillant.
C’est une constante. Chez les Merah, le père investit très peu son rôle d’autorité autrement que par l’exercice de la violence, il subvient peu aux ressources du ménage et néglige son foyer. Il en est de même pour la vingtaine de jeunes de la cellule Cannes-Torcy dont les pères apparaissent comme des figures contestées en raison de leur comportement brutal ou de leur incapacité à assumer leur rôle de cadrage ou d’accompagnement. L’absence intermittente et régulière du père peut aussi être observée. C’est notamment le cas des auteurs des attentats de Barcelone et de Cambrils de 2017, ceux de « la cellule Ripoll » que j’ai étudiée longuement entre 2018 et 2020. Cette absence et/ou ce rejet de la figure paternelle doublée de ces crises familiales à répétition expliquent en partie la raison pour laquelle ces jeunes sont à la recherche d’une famille proposant un cadre sécurisant et stable. Certains, avant de se radicaliser ont même tenté la voie de l’Armée pour répondre à leur quête d’encadrement et d’ordre.
C’est ce que vous appelez la néo-Umma, une communauté djihadiste imaginaire et largement fantasmée mais qui répond à ce besoin de famille.
Ce sont des entités autonomes, de petites communautés de copains fondés sur un sentiment de fraternité partagé. Elle est sensée être harmonieuse et unifiée à l’image du Dieu unique et de l’islam unitaire, qui exclue tous ceux qui n’adhèrent pas aux normes de l’islam ultra-orthodoxe : les infidèles, les hérétiques et les mauvais musulmans. La néo-Umma djihadiste incarne la famille idéale : organisée, hiérarchisée et très structurée à l’opposé du modèle de la famille moderne, avec des normes qui proviendraient de Dieu et non des institutions humaines, considérées comme contingentes et instables.
Dans les communautés que vous avez étudiées, on observe souvent la présence de fratries, comment l’expliquez-vous ?
C’est une régularité en termes sociologiques. Il y a Mohammed Merah et son frère ainé : Abdelkader mais aussi Fabien et Jean-Michel Clain membres de la filière d’Artigat. Dans la cellule djihadiste espagnole que j’ai étudiée, il y a quatre fratries, mais il y a aussi Brahim et Salah Abdeslam ou les Bakkraoui pour les attentats de Paris, les frères Kouachi pour l’assaut contre Charlie Hebdo pour ne citer qu’eux. … Ces communautés regroupent parfois plusieurs membres d’une même famille : des frères et sœurs, des cousins, des parents par alliance. On peut penser que dans ces familles où les liens se sont délités, le fait de participer ensemble à des projets terroristes procure un sentiment d’une cohésion qui tient lieu de liens familiaux. Ces liens de sang assurent aussi une confiance aveugle pour mener à bien cette guerre sainte contre les impies.
Cette néo-Umma peut-elle être considérée comme une famille apaisante ?
Elle permet à la personne de sortir de sa solitude et de se « re-familiariser » pour utiliser notre vocabulaire dans le livre. C’est une famille au sens affinitaire du terme: on rétablit des liens affectifs et sociaux, on se marie entre soi, on partage des valeurs communes. Pour ces jeunes ré-islamisés ou nouvellement convertis, la religion, dans sa version extrémiste permet en outre de « ré-esthétiser » le monde et redonne sens à sa vie. Cette nouvelle famille permet de se reconstruire une identité, de s’identifier à un projet collectif et de partager un sort commun. Tout cela étant sous-tendu par un sentiment d’aliénation et d’humiliation parfois liée à l’histoire familiale et qui constituent autant de vulnérabilités individuelles captées par l’Islam radical.
La violence est pourtant partie intégrante de l’idéologie djihadiste, n’y a-t-il pas contradiction ?
L’idéologie djihadiste se positionne en tant que structure défensive face aux infidèles, aux mécréants qui ne partagent pas la vision de cet Islam intransigeant. C’est cet idéal de haine de l’Autre qui est partagé entre les membres de la communauté et qui va les conduire à des logiques de violence et de destruction. En soulignant bien que la compétence de cette ultra-violence n’est pas donnée à tout le monde. Elle nécessite une socialisation particulière.
Qui sont les pères et les mères dans ce nouveau modèle de famille ?
Si je reprends l’analyse de Farhad Khosrokhavar développée dans le livre, la néo-Umma occupe une place symbolique essentielle, celle de la mère. La fonction du père est assumée par le Calife qui incarne le nouvel Etat islamique, mais cela peut-être aussi un père de substitut : souvent un Imam charismatique et souvent éloigné des mosquées. Ces Imams idéologues ont cette capacité de créer une cohésion, d’établir des relations de confiance et de complicité avec ces jeunes convertis, mais surtout de mettre en mot une souffrance sociale. Le cas d’Olivier Corel, l’Emir blanc à la tête de la communauté d’Artigat fréquentée par Merah est un cas à part. Il incarne le chef de famille discret et apaisant qui sait écouter les confidences, conseille sur la vie maritale, célèbre les mariages selon la loi islamique. Ce n’est pas une personne adepte du djihad, ce qui n’empêchera pourtant pas des membres de sa communauté d’embrasser cette idéologie mortifère.
Ce qui caractérise aussi ces communautés, c’est la distinction très forte entre l’homme et la femme, c’est le retour du patriarcat.
Oui, c’est un système rigide et cadré, à l’inverse des rapports hommes femmes que la modernité a rendu compliqués. L’homme est le pilier de la famille, il a vocation à s’engager dans la voie de Dieu et de se faire martyr en luttant à mort contre l’ennemi. Il n’est là que pour une période déterminée face à la femme qui incarne la stabilité. Elle a un rôle de reproductrice, d’éducation de ses enfants dans l’idéal islamiste et assure la survie de la communauté au sein de la famille néo-Umma djihadiste. Parmi les jeunes hommes et femmes radicalisés étudiés, leur départ en Syrie a été concomitant à la volonté de fonder une famille selon ce modèle patriarcal.
La thèse que vous développez dans ce livre pour expliquer la radicalisation djihadiste de ces jeunes est à mille lieues de celle du « tout religieux » défendue par des auteurs, comme Gilles Kepel …
La thèse selon laquelle l’islam fondamentaliste serait au fondement du terrorisme et suffirait à expliquer le passage à l’acte est effectivement loin de nous satisfaire. En réduisant la radicalisation djihadiste à un simple primat du religieux, ces auteurs occultent les déterminants sociaux très singuliers permettant de comprendre l’ensemble des processus de radicalisation. Elle présente en effet une image faussement transparente d’une réalité où le religieux entre en symbiose avec des déterminants sociaux, économiques, urbains mais aussi, c’est notre thèse, surtout familiaux. De même que réduire la radicalisation comme on le fait souvent, à l’Islam est tout aussi simpliste. On peut aussi se radicaliser au nom d’autres idéologies : le néonazisme ou le néofascisme en Europe, le suprématisme blanc ou plus prés de chez nous : le nationalisme basque que j’ai beaucoup étudié. Si l’on veut combattre ces phénomènes de radicalisation, il faut les comprendre, persévérer dans nos recherches en faisant l’effort de surmonter la peur et le dégoût que ces actes nous inspirent.
Jérôme Ferret est enseignant-chercheur à l’Université Toulouse 1 - Capitole, avec une habilitation à diriger la recherche obtenue à l'EHESS (garant Michel Wieviorka), en sociologie et directeur adjoint de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T, UAR 3414, Cnrs). Actuellement en délégation CNRS au Latts, Paris, Ecole des Ponts Paris Tech.
Farhad Khosrokhavar est directeur d'études à l'EHESS et spécialiste mondialement reconnu de l'islam politique et du djihadisme.
Références bibliographiques
-
Jérôme Ferret et Farhad Khosrokhavar, Family and Jihadism. A Socio-Anthropological Approach to the French Experience, London, Routledge Taylor and Francis Group, 2022. Cet ouvrage a bénéficié du soutien financier de l’ANR Sov, FMSH, MSHS-T, 2016-2020
-
Farhad Khosrokhavar, Le nouveau jihad en occident, Paris : Robert Laffont, 2018. https://www.franceculture.fr/oeuvre/le-nouveau-jihad-en-occident-0
-
Jérôme Ferret, Bruno Domingo et Fahrad Khosrokhavar, « Pour une lecture anthropologique, comparée et située de la radicalisation », « Radicalizations. Comparative Lessons », in Report International Panel on Exiting Violence, IPEV, Carnegie Corporation, Paris: éditions de la FMSH, pp. 12-34. https://www.ipev-fmsh.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapport_Violence_web-1.pdf
-
Fabien Truong (2017), Loyautés radicales. L’islam et les « mauvais garçons » de la Nation, Paris, La Découverte.
-
Eric Marlière, La fabrique sociale de la radicalisation ; une contre-enquête sociologique, Berger-Levrault, Collection : Au Fil Du Débat, 2021.