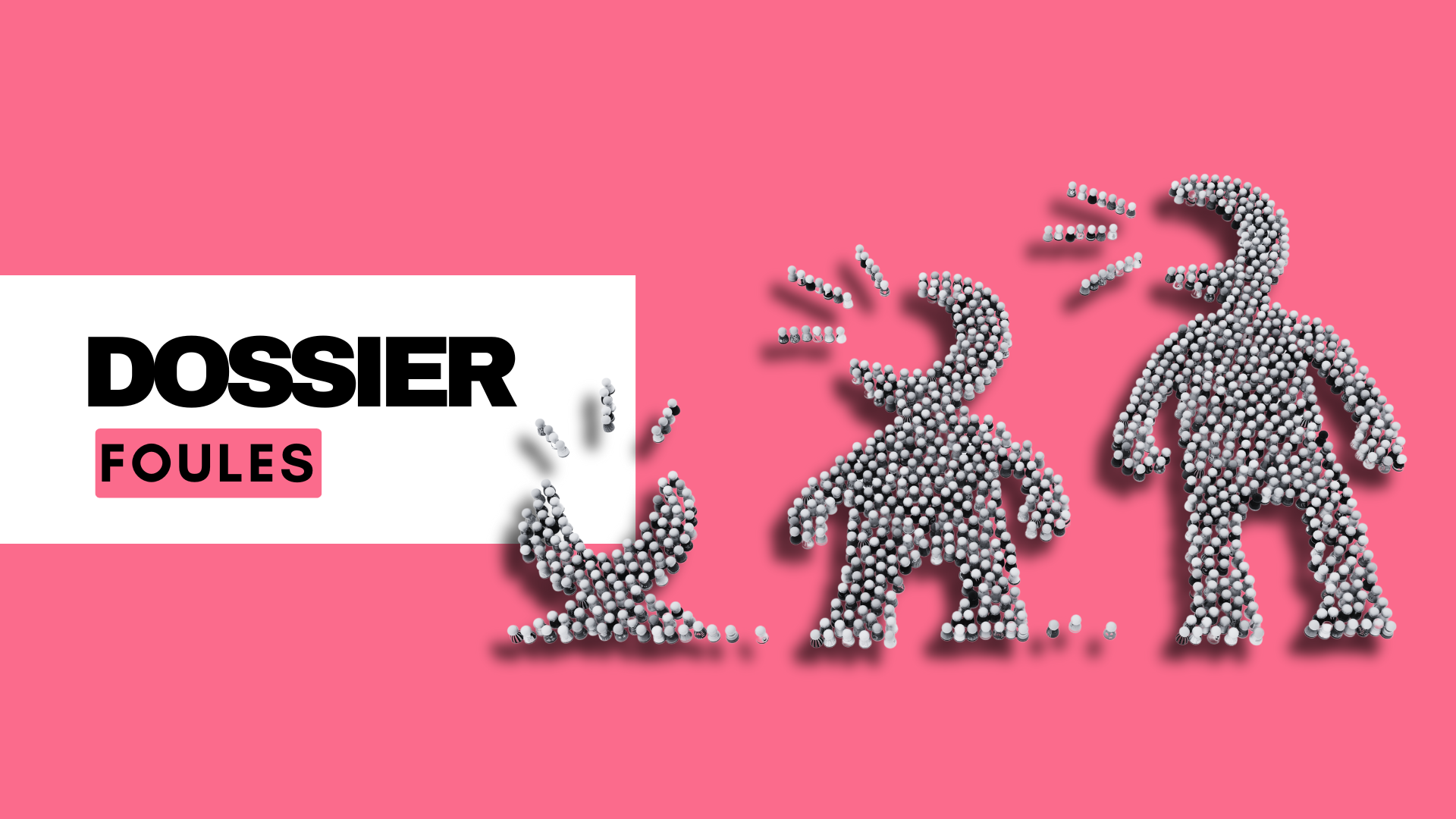Bastien, boxeur de pensées

Faut-il écouter le cœur l’instinct ou la raison ? Les situations de conflits, où nos pensées s’affrontent telles deux boxeuses sur un ring, Bastien Trémolière, enseignant-chercheur en psychologie cognitive, en a fait son terrain de jeu. Comme Blaise Pascal interrogeait les limites de la raison et la puissance de l’intuition dans ses Pensées, Bastien nous montre comment étudier la pensée humaine et nos choix face à des questions morales. Un combat réflexif, de la philosophie à l’intelligence artificielle.
La série Les deux font la paire met en scène des couples insolites : un·e scientifique se prête au jeu de l’interview avec un objet du quotidien pour tirer un portrait décalé de celles et ceux qui font la science.
Faut-il punir Bastien ?
Mettez-vous un instant à la place d’un·e juge : ne vous inquiétez pas, l’affaire qui nous concerne n’est pas complexe (en apparence). Les faits sont les suivants : Bastien a fait mal à Pierre. Faut-il punir Bastien ? Dans une situation aussi simple, on pourrait répondre oui, basique. Mais attendez, il nous manquait un élément, reprenons les faits : Bastien a fait mal à Pierre, mais il ne l’a pas fait exprès. Là, deux chemins de pensée s’offrent à vous. Tout d’abord, on peut s’attarder sur la douleur de Pierre (il a le bras cassé le pauvre…). Ce premier processus, instinctif et fortement lié aux émotions, devrait plutôt vous inciter à punir Bastien. Maintenant, on peut s’intéresser à l’intention de Bastien : il n’a pas fait mal à Pierre volontairement. Sous ce prisme, vous aurez plutôt tendance à exonérer Bastien d’une punition ou à faire preuve de clémence. Alors, comment on se débrouille ? Comment font les décideur·euses pour trancher dans un pareil cas de figure ?
Cet exemple, c’est celui d’un conflit cognitif, et c’est justement la thématique de recherche de Bastien Trémolière, enseignant-chercheur en psychologie cognitive (et qui n’a jamais fait de mal à Pierre, on vous rassure). Une théorie actuellement étudiée dans cette discipline est celle du modèle à deux vitesses (ou dual process en anglais), notamment popularisée par les travaux du psychologue Daniel Kahneman, qui stipule que nous aurions deux systèmes de pensée distincts. Le premier fait appel à des mécanismes de réflexion très rapides et inconscients, on peut ainsi parler d’intuition. La plupart du temps, il nous permet de prendre des décisions et de se faire un avis rapidement de manière appropriée. Le deuxième système de pensée est lui plus lent, et correspond à une véritable réflexion consciente et contrôlée. C’est ce qu’a voulu représenter Bastien en choisissant pour objet Le Penseur de Rodin : « Le Penseur me fait penser vraiment à ce moment de réflexion, à la mobilisation du système de pensée réflexive. C’est le fait de se dire : hop hop hop, les intuitions, on va les laisser de côté un petit moment, je vais m'asseoir, je vais réfléchir un petit peu plus longuement... ».

Les conflits cognitifs, ce sont donc ces situations de combat, avec d’un côté du ring, l'intuition qui nous dit va à gauche et de l’autre côté, la réflexion et la raison qui vont nous dire va à droite. Bastien cherche ainsi à les étudier lorsqu’ils émergent dans des contextes de jugement moral (comme dans notre exemple ci-dessus), mais aussi sur d’autres thématiques, comme le climato-scepticisme ou le refus de la vaccination.
La psychologie : des questions de vie et de mort ?
Mais alors, comment devient-on docteur en psychologie et boxeur de pensées ? Vers l’âge de 13-14 ans, Bastien souhaitait devenir éducateur spécialisé : « J’ai été confronté, comme ça peut arriver à d’autres, à des difficultés familiales, et finalement j’ai eu l’impression d’arriver à les affronter. Et à ce moment-là je me suis dit : tiens, si j'y suis arrivé sans trop perdre de plumes, peut être que je pourrais essayer à mon niveau d’aider les autres ».
À l’époque, on lui conseille de passer d’abord par la psychologie, au moins une année, avant de rentrer dans une école d’éducateur·ices spécialisé·es. Et cette première année se passe bien, si bien que Bastien décide de pousser un peu. Petit à petit son projet professionnel évolue, il souhaite désormais devenir psychologue clinicien. Mais en troisième année de licence, une rencontre va orienter la suite de ses études : « J’ai eu un enseignant, Eric Raufaste, qui m’a donné goût à la psychologie cognitive. Moi je voyais ça comme quelque chose de très froid, où on étudiait l'esprit humain comme celui d'un ordinateur. Et je me suis rendu compte qu'en fait non, il n’y avait pas du tout ce côté mécanique, mais des choses beaucoup plus exotiques ! »
« Lorsqu'on apprend des choses, on ne rajoute pas simplement un nouveau livre dans sa bibliothèque [mentale], mais on va la restructurer, et réussir à créer des ponts entre les idées. »
C’est donc décidé, Bastien se lance dans un master de psychologie cognitive et va faire une autre rencontre « déterminante pour tout [son] parcours » : Jean-François Bonnefon. Chercheur CNRS et psychologue cognitiviste, il inscrit ses travaux à la croisée des sciences de l’information, de la psychologie et de l’économie. Bastien se lancera finalement dans une thèse sous sa direction où il interrogera rationalité et conscience de la mort, avec des questions telles que : Sommes-nous capables de raisonner de manière rationnelle lorsque nous pensons à notre propre mort ? Quel est le réel impact des pensées de mort sur notre raisonnement, nos jugements et décisions ? (On vous met le lien vers la thèse en fin d’article. Spoiler alert : les personnes qui ont pensé à leur propre mort montrent des comportements plus intuitifs, au détriment des règles normatives de raisonnement.)
Une fois sa thèse soutenue en 2013 et son statut de docteur en psychologie cognitive en poche, Bastien part continuer ses recherches pendant deux ans au Québec, puis cinq ans à l’Université de Nîmes, avant de revenir dans la ville rose : « J'avais cette appétence pour revenir sur Toulouse, que ce soit la ville ou les conditions de recherche avec des laboratoires qui sont relativement bien avancés, en tous cas dans lesquels on pouvait s’épanouir. »
« Le premier savoir est le savoir de mon ignorance : c’est le début de l’intelligence »
Cette citation attribuée à Socrate (Ve siècle avant notre ère) résonne chez Bastien : « J’aime bien cette idée de dire que lorsqu'on ne connaît pas et bien, faisons tabula rasa [table rase], et acceptons qu'on ne sait pas et qu'on va apprendre petit à petit ».
Pour Bastien, apprendre est un plaisir « venu sur le tard », et c’est bien plus qu’une simple accumulation de savoirs. Imaginez ainsi que l’ensemble de vos connaissances soient représentées par une bibliothèque, où chaque livre correspondrait à une idée : « lorsqu'on apprend des choses, on ne rajoute pas simplement un nouveau livre, mais on va restructurer toute la bibliothèque, et réussir à créer des ponts entre les idées, et cette gymnastique intellectuelle, c’est quelque chose que j’aime beaucoup », image le chercheur.

Chercher, ou la liberté de choisir et de penser
En parlant de bibliothèque, Bastien cite son goût de la littérature, et plus spécifiquement des livres d’Isaac Asimov, dans lesquels transparaît selon lui une « créativité folle pour l’époque ». « On a toutes et tous déjà été confronté à la page blanche, et en recherche on peut littéralement se poser la question : Qu’est-ce que je vais rechercher ? Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou je change d’objet d’étude ? Et si je change, est-ce que je peux y arriver ? Parfois les idées bouillonnent et ça crée un vrai challenge, quelque chose de presque intrusif et je trouve ça très excitant. En tant que chercheur, on a une grande liberté de choix dans les sujets que l’on traite, et je m’estime particulièrement chanceux, parce que ce n’est malheureusement pas donné à tout le monde d’avoir un métier que l’on aime et dans lequel on peut s’épanouir. »
À l’heure où les libertés académiques sont contestées dans de nombreux pays, Bastien tient à souligner la chance dont lui et ses collègues chercheur·es bénéficient : « On a une grande liberté, et ça vaut tout l’or du monde ».
Un monde de pensées sans fin ?
Avec toute cette introspection (et parce que ses travaux de recherche portent précisément sur le raisonnement) on pourrait se dire que Bastien est un penseur hors-pair, imperméable aux biais cognitifs : « Ça m’est peut-être venu à l’esprit, en me disant : Comme tu travailles sur le raisonnement tu vas devenir un super raisonneur, et éviter les biais cognitifs. Et bien pas du tout ! »
Aura-t-on un jour fait le tour de la recherche en psychologie cognitive ? Déjà, il faut bien avouer que cela fait des siècles qu’on travaille à comprendre comment nous pensons, et ce dès la philosophie classique (on citait Socrate quelques lignes plus haut !), et que de nouvelles théories et concepts continuent d’émerger. Mais surtout, la psychologie cognitive trouve des applications très concrètes au-delà de l’être humain, par exemple avec l’intelligence artificielle, comme en témoigne Aniti (l'institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse ) composé de chercheur·es venu·es de tous les domaines, dont la psychologie.
Jean-François Bonnefon contribue notamment aux réflexions autour de l’éthique de l’intelligence artificielle (voir notre article « IA génératives : regards croisés des chercheur·es ANITI »). Un exemple assez connu est celui de la voiture autonome : en cas de problème de frein, doit-elle continuer d’aller tout droit pour vous sauver mais au risque de renverser cinq personnes, ou doit-elle vous sacrifier pour les sauver ? Pour Bastien, « l’intelligence artificielle, on est en plein dedans avec une chose qui est très intéressante, c'est que pendant très longtemps, notamment sur tout ce qui tourne autour de cette sphère morale, on a été critiqué dans le sens où ce qu’on faisait, c'était totalement fictif, un petit peu décalé. Mais maintenant, on se rend compte que tout ce qui était initialement philosophique, puis repris par la psychologie, va commencer à avoir une utilité pour la société, et cela va certainement être exponentiel dans les prochaines années ».
Notre boxeur de pensées ne se fait donc pas de soucis quant aux perspectives de recherche en psychologie cognitive : « Dans le petit domaine que je connais, on a accumulé quand même beaucoup de connaissances et pendant très longtemps, on étudiait le raisonnement pour comprendre le raisonnement. Aujourd’hui on passe à une autre période : on utilise nos connaissances pour aider les gens et l’humanité, les décideurs, les politiques… ».
Bastien Trémolière est enseignant-chercheur en psychologie cognitive à l’Université Toulouse – Jean Jaurès, au sein du laboratoire cognition, langues, langage, ergonomie - CLLE (CNRS, Université Toulouse – Jean Jaurès, Université Bordeaux Montaigne).
Aller plus loin :
La rationalité des mortels : les pensées de mort perturbent les processus analytiques, Bastien Trémolière, 2013
Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée, Daniel Kahneman, 2011
Les deux font la paire est une série Exploreur - Communauté d'universités et établissements de Toulouse. Coordination et suivi éditorial : Clara Mauler, Gauthier Delplace et Hélène Pierre. Photos : ©Sébastien Chastanet. Studio photos : Maison de l'image et du numérique, Université Toulouse - Jean Jaurès. Ces recherches et cet épisode ont été financé·es par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Cet épisode est réalisé et financé dans le cadre du projet Science Avec et Pour la Société « CONNECTS » porté par la Communauté d'universités et établissements de Toulouse et financé par l’ANR.