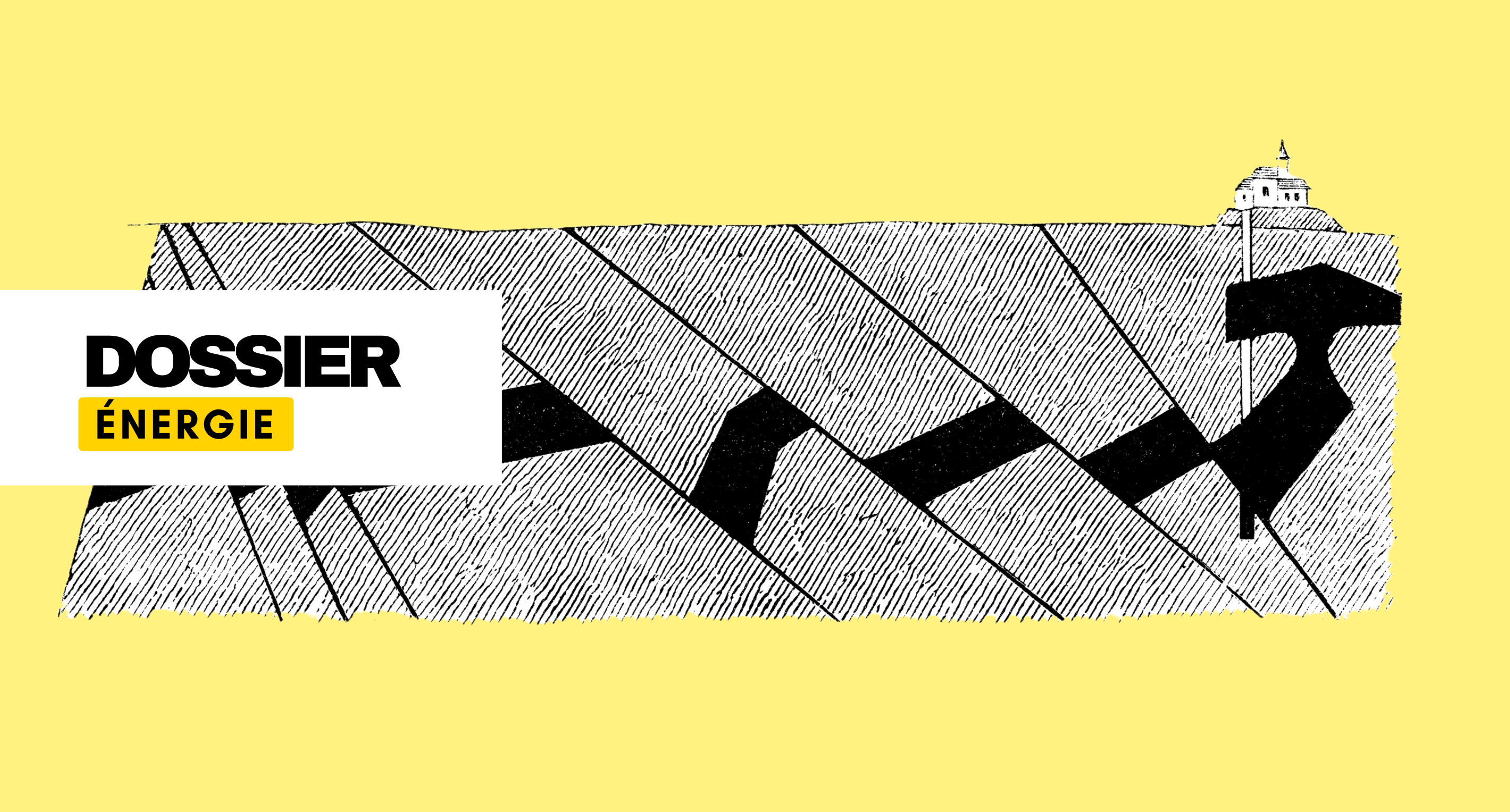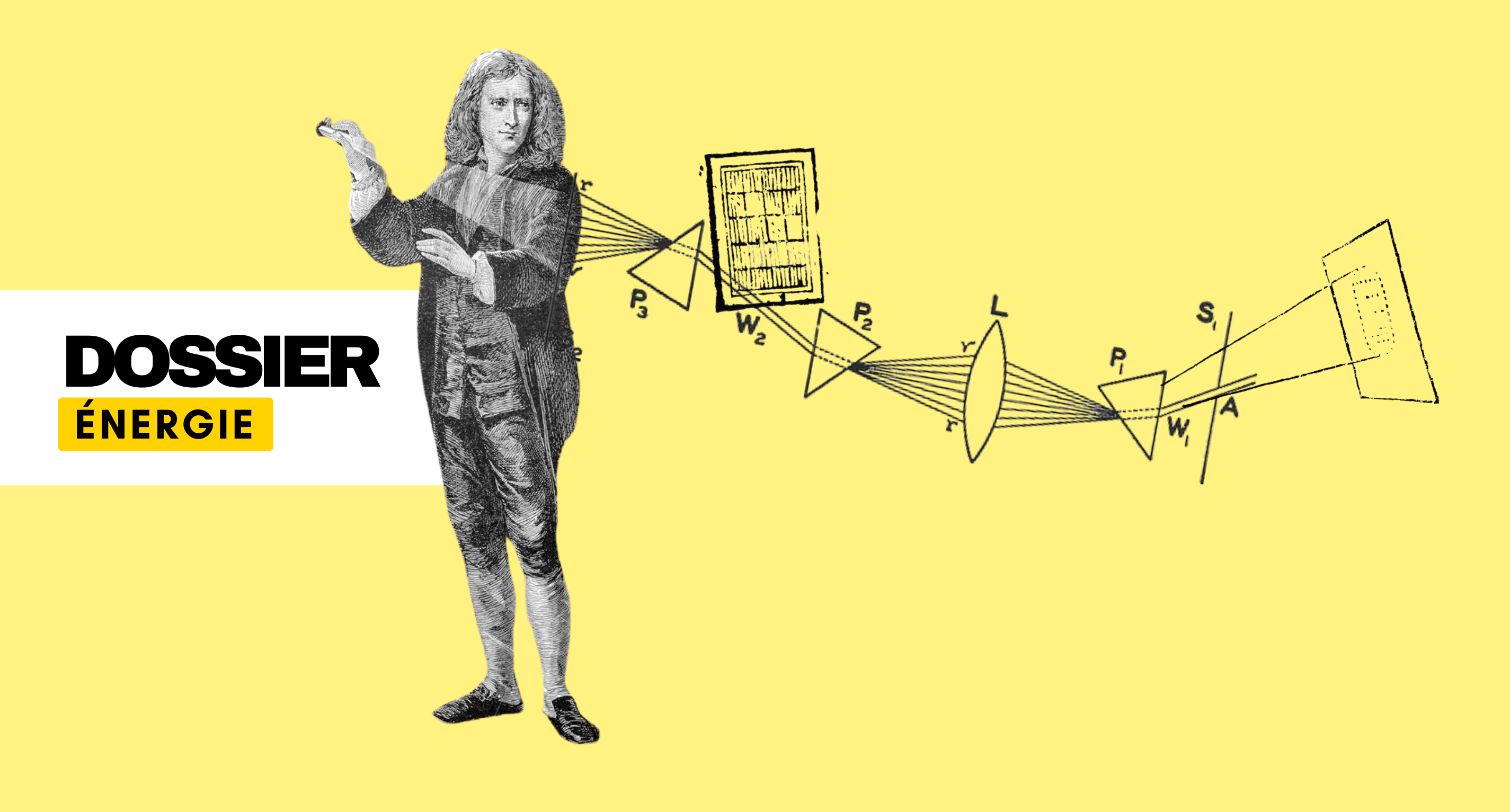Hydrogène : un vent d’air frais ?
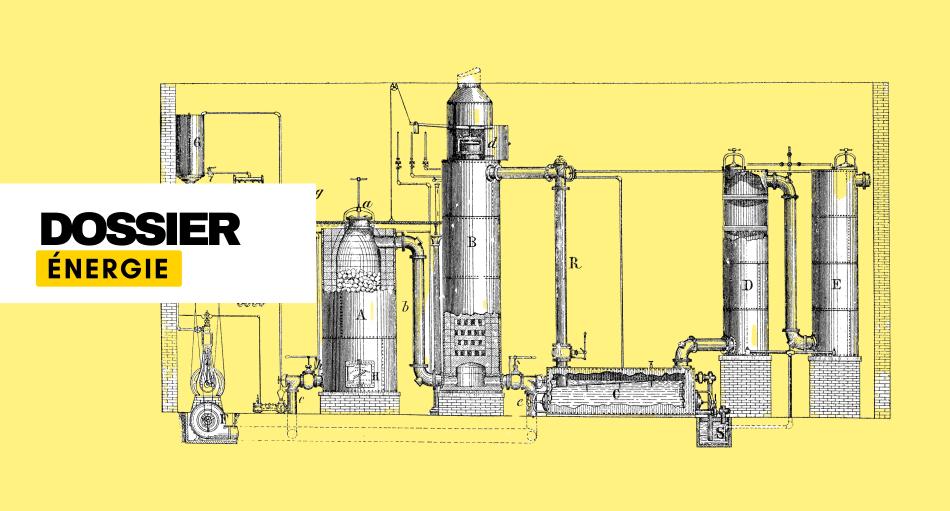
L’hydrogène souffle comme un vent d’air frais face aux enjeux de la transition énergétique. Un pôle de recherche et d’innovation dédié a été créé en Occitanie, à Toulouse. Destiné à renforcer les recherches sur le sujet et à améliorer les liens avec l’écosystème industriel et économique, ce pôle rassemble 25 laboratoires et 200 personnels de recherche.
La nécessité de trouver des sources d’énergie alternatives non émettrices de gaz à effet de serre mobilise des scientifiques toulousain·es, à l’image de Marc Prat et Christophe Turpin qui nous présentent le pôle de recherche RHyO (recherche et innovation sur l’hydrogène en Occitanie). Parmi le panel d’options visant à limiter ou réduire nos émissions de CO₂, soit - décarboner - différents secteurs d’activité, l’utilisation de l’hydrogène dit « vert » est ici étudiée. Cela exige de relever de nombreux défis scientifiques et technologiques liés aux problématiques de production, stockage, utilisation, et sécurité, en particulier pour la production d’énergie. À ceci s’ajoutent les défis liés à la compétitivité et l’acceptabilité sociale de l’hydrogène.
Hydrogène « noir », « gris » ou « vert » ?
Actuellement, l’hydrogène - H₂ - est utilisé comme matière première dans l’industrie chimique, notamment pour les engrais de l’agro-industrie et pour le raffinage d’hydrocarbures. Pour ces usages, cet hydrogène est produit à partir de combustibles fossiles, par un procédé très émetteur de CO₂ (le « reformage »). On l’appelle alors hydrogène « noir » (quand il est produit à partir de charbon) ou « gris » (produit à partir de gaz naturel fossile).
Selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie « Global Hydrogen Review 2023 » : en 2022, 62% de l'hydrogène produit dans le monde est « gris », 21% est « noir », 16% est un co-produit du raffinage du pétrole (donc émetteur de CO₂), et « moins de 1% de la production [mondiale] d'hydrogène est à faible émission [de gaz à effet de serre] », dont une partie provient d'énergie fossile avec du captage de CO₂.
Si vous avez voyagé dans un train ou bus à hydrogène, vous avez probablement eu l'impression d'un voyage peu carboné, alors que cet hydrogène avait très probablement nécessité d'émettre beaucoup de CO₂.
Si vous avez voyagé dans un train ou bus à hydrogène, vous avez probablement eu l'impression d'un voyage peu carboné, alors que cet hydrogène avait très probablement nécessité d'émettre beaucoup de CO₂. Un procédé qui utiliserait de l’hydrogène « noir » ou « gris » n’est en effet pas décarboné. De la même manière que l’électricité peut être décarbonée ou non.
Quand on évoque le potentiel de l’hydrogène dans la décarbonation, c’est autre chose. Il doit être produit via la technologie de l’électrolyse de l’eau (un procédé qui décompose l'eau - H₂O - en dioxygène - O₂ - et dihydrogène gazeux - H₂ - grâce à un courant électrique qui provient d’énergies renouvelables). On l’appelle alors communément l’hydrogène « vert ».
Il s’agit d’un mode de production bas-carbone et renouvelable pour de nouveaux usages : comme vecteur d’énergie dans les transports, pour la production d’électricité, le chauffage domestique ou dans des procédés de décarbonation de différents secteurs (métallurgie, chimie, agro-alimentaire...).
Selon la Commission européenne, « la demande initiale d'électricité pour la production d'hydrogène sera négligeable, mais elle augmentera vers 2030 avec le déploiement massif d'électrolyseurs à grande échelle ». Et comme on le rappelait plus haut, l'électricité peut être elle-même décarbonée ou non...
Structuration d’un pôle de recherche et d’innovation
Historiquement impliqués dans la recherche sur l’hydrogène, plusieurs laboratoires d’Occitanie sont au cœur du pôle RHyO destiné à favoriser la structuration de la communauté scientifique régionale autour de cette thématique. Le pôle RHyO rassemble 25 laboratoires et 200 personnels de recherche (enseignant·es-chercheur·es, chercheur·es, ingénieur·es de recherche…), en lien avec des industriels. « RhyO a pour objectif de développer les connaissances et de contribuer à lever les verrous technologiques », explique Marc Prat, chercheur CNRS à l’Institut de mécanique des fluides de Toulouse et directeur du pôle.
L’effort de structuration lié à la mise en place du pôle a par exemple permis d’obtenir un financement de près de 2,5 millions d’euros, via le projet H2 VERT auprès du fonds européen de développement régional.
Hydrogène et énergie
Une vingtaine de doctorant·es se sont penché·es sur les questions de production, transport, stockage et utilisation de l’hydrogène décarboné comme vecteur énergétique. On parle de l’hydrogène comme un vecteur énergétique et non pas comme une source d’énergie, car il doit être produit puis stocké avant d’être utilisé.
« Pour ce qui concerne la production d’hydrogène, explique Marc Prat, le projet H2 VERT a porté sur la production d’H₂ par l’électrolyse [déjà vu plus haut], la photocatalyse [le « craquage » de l'eau par photocatalyse consiste à utiliser des photons suffisamment énergétiques pour « craquer » les molécules d'eau - H₂O - et obtenir du dioxygène et dihydrogène], et la transformation de la biomasse [conversion en hydrogène de matières organiques végétales, animales, bactériennes ou fongiques via différentes techniques qui visent à extraire l'hydrogène de ses composants, tels que les glucides, les lipides et les protéines]. »
« Pour ce qui est du stockage de l’hydrogène à l’état solide, liquide ou compressé, le projet a permis d’étudier deux technologies prometteuses et susceptibles d’apporter des innovations de rupture. La première concerne la mise au point d’un nouveau matériau poreux permettant le stockage de l’H₂ à température ambiante. La seconde concerne le stockage dans des liquides organiques transporteurs d’hydrogène [un composé organique liquide, ou un mélange de tels composés, capable de fixer puis de libérer de l'hydrogène à travers des réactions chimiques] », complète le chercheur.
Enfin ce projet a permis l’étude de la production d’énergie par la combustion d’hydrogène, plus spécifiquement « de [son] utilisation pour la production de chaleur dans des chaudières industrielles », précise Marc Prat.
En parallèle, les ambitions autour de l’hydrogène se concrétisent à travers le Technocampus hydrogène Occitanie, destiné à remplacer l’actuelle plateforme hydrogène répartie sur quatre sites toulousains. Le projet, initié par la Région Occitanie, en collaboration avec le CNRS et les industriels de l’aéronautique (Airbus et Safran notamment) est porté par Christophe Turpin, chercheur CNRS et responsable des activités hydrogène du laboratoire plasma et conversion d'énergie à Toulouse.
« Ce sera, explique Christophe Turpin, le plus grand centre européen de recherche, d'essai et d'innovation technologique dédié à l'hydrogène « vert ». Le Technocampus hydrogène Occitanie a un triple objectif : accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs essais et le test de leurs prototypes, proposer un espace expérimental sur l’hydrogène aux laboratoires et former aux technologies hydrogène. En mutualisant les bancs de tests et les grands équipements de recherche technologique, nous accélérerons fortement sur l’hydrogène « vert » avionnable. »
Un avion à hydrogène ?
En raison du poids industriel de l’aéronautique, la Région Occitanie est particulièrement intéressée par l’objectif fixé par le gouvernement français de développer un avion à hydrogène « vert ».
Au-delà même des verrous technologiques à dépasser, il est intéressant, explique Marc Prat, « de mieux connaitre la filière de l’hydrogène, ainsi que les différentes initiatives prises par les régions, comme à l’échelle nationale ou européenne pour développer l’ensemble du secteur industriel concerné par l’hydrogène décarboné ».
Au sein du pôle RHyO, le projet de recherche PPH2 (passé et présent de l’emploi de l’hydrogène dans la filière aéronautique. Acteurs, enjeux et problématiques économiques et sociotechniques) porté par Med Kechidi, enseignant-chercheur en sciences de gestion à l’Université Toulouse - Jean Jaurès, associe des scientifiques de différentes disciplines (histoire, économie, gestion, géographie). « L’étude vise en particulier à dresser un bilan de l’emploi de l’hydrogène et à comprendre comment une filière se construit sur un territoire. Quels ont été́ les projets développés par le passé dans le monde et qui en ont été́ les acteurs ? Quelles perspectives offre l’hydrogène pour un développement régional et territorial fondé sur la transition écologique ? Comment l’Occitanie s’engage-t-elle dans la construction d’une filière de l’hydrogène ? Quels sont les acteurs de cette filière ? Quel type de liens développent-ils (ou non) entre eux ? »
Une autre question traitée est celle de la compréhension du sujet et de son acceptabilité par la société. Le pôle RHyO a ainsi un axe de recherche spécifique intitulé « Hydrogène & société ». « L’objectif, explique Marc Prat, est notamment de contribuer à alimenter le dialogue avec les citoyens et d’étudier les enjeux sociétaux et économiques liés au déploiement des technologies hydrogène. La mémoire collective est marquée par le crash du dirigeable Zeppelin Hindenburg en 1937, une étincelle ayant alors enflammé une fuite d’hydrogène. Près de 90 ans après, comme pour d’autres technologies, un travail est à mener non seulement pour maîtriser la sécurité des technologies de l’hydrogène mais aussi pour faire comprendre leurs spécificités et leurs aspects sécuritaires auprès des citoyens. »
« L'hydrogène représentera entre 20 et 25% de la consommation mondiale d'énergie d'ici à 2050. Les 75% restants devront être couverts par d'autres solutions énergétiques. »
Quoi qu’il en soit, l’utilisation de l’hydrogène, même si elle représente une option de premier plan, est à envisager parmi un bouquet de solutions. Dans sa projection optimiste, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que l'hydrogène représentera entre 20 et 25% de la consommation mondiale d'énergie d'ici à 2050. Cela signifie que les 75% restants devront être couverts par d'autres solutions énergétiques.
Marc Prat est chercheur CNRS en mécanique des fluides à l’Institut de mécanique des fluides de Toulouse - IMFT (CNRS, INP, Université de Toulouse). Il est directeur du pôle RHyO (recherche et innovation sur l’hydrogène en Occitanie).
Christophe Turpin est chercheur CNRS en génie électrique et responsable des activités hydrogène au sein du laboratoire plasma et conversion d'énergie - Laplace (CNRS, INP, Université de Toulouse).
Les dossiers Exploreur explorent un sujet en croisant le regard de plusieurs disciplines scientifiques. Journaliste : Emmanuelle Durand-Rodriguez. Visuel : Delphie Guillaumé et Caroline Muller (à partir de l'illustration libre de droits "Thaddeus S. C. Lowe était un aéronaute, scientifique et inventeur de la guerre de Sécession. Il a inventé le procédé de gaz d’eau par lequel de grandes quantités d’hydrogène gazeux pouvaient être produites à partir de vapeur et de charbon", Luisa Vallon Fumi). Coordination et suivi éditorial : Clara Mauler, Johanna Calles, Simon Leveque, Manon Mesones-Tastu.